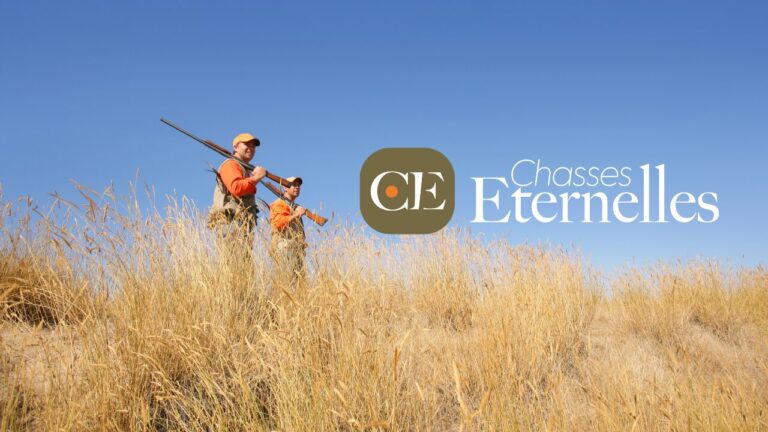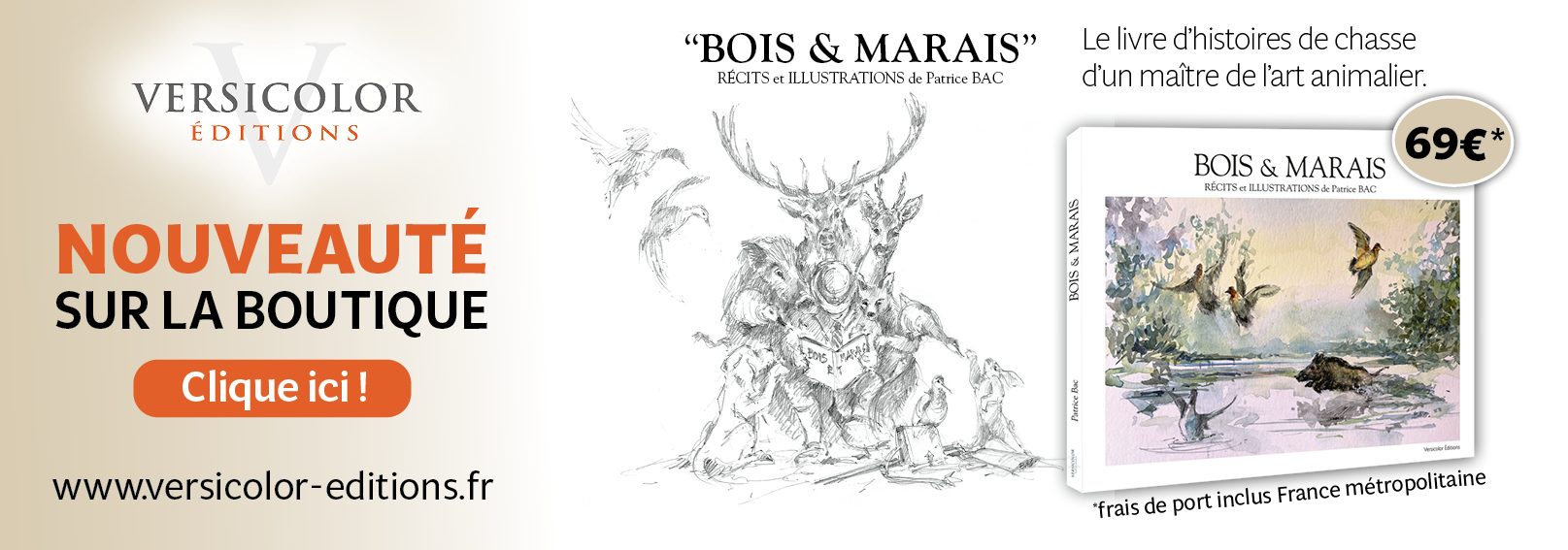Derrière l’appel à la dissolution de la cellule Déméter, c’est moins la défense des libertés que la légitimation d’un activisme hors la loi qui se dessine.

Le 6 avril, Le Monde a publié une tribune collective intitulée « La cellule Déméter menace les militants animalistes et environnementalistes, ainsi que les libertés associatives », signée par quelque 120 personnalités issues de la mouvance écologiste, animaliste ou des droits humains. Si le titre annonce une menace grave pour la démocratie, la lecture attentive du texte révèle surtout une opération de communication bien rodée, reposant sur des amalgames, des approximations et une volonté manifeste de diaboliser un outil de renseignement au service de la sécurité publique.
⚠️ La "cellule Déméter" s’attaque aux lanceurs d’alerte qui défendent les animaux et notre planète. Un outil de répression indigne d’un État démocratique !
— PETA France (@PETA_France) April 7, 2025
PETA est signataire de cette tribune initiée par @L214, pour nos libertés fondamentales. ✊🌱https://t.co/U2GDSDaN3s
Une tribune fondée sur un procès d’intention
La cellule Déméter, créée en 2019 au sein de la gendarmerie nationale, a pour mission de prévenir les atteintes aux biens agricoles et de mieux comprendre les formes d’activisme qui ciblent le monde rural. Ce simple rappel factuel est absent de la tribune. Les signataires préfèrent dénoncer une prétendue « dérive autoritaire » et agiter le spectre du « délit d’opinion ». Or, il ne s’agit pas de surveiller les idées, mais de documenter les actions à caractère idéologique lorsqu’elles franchissent les bornes de la légalité, comme les intrusions dans les élevages, les dégradations de matériels ou les menaces adressées à des exploitants.
Les auteurs de la tribune dénoncent le fait que la cellule Déméter se penche sur des « actions de nature idéologique ». Ils omettent de préciser que c’est précisément parce que certaines actions militantes s’appuient sur une idéologie radicale qu’elles peuvent déborder dans l’illégalité. Il ne s’agit pas de ficher des opinions, mais de suivre des comportements à risque. À les lire, on pourrait croire que Déméter traque des végétariens exprimant paisiblement leur désaccord avec l’élevage intensif. La réalité est plus nuancée.
Des chiffres minimisés pour mieux décrédibiliser
La tribune critique également la justification initiale de la création de Déméter, fondée sur le concept d’« agribashing », que les signataires qualifient de « pure invention ». Pour appuyer leur propos, ils citent un chiffre avancé par la FNSEA : 41 intrusions en 2019, soit seulement 0,28 % des faits enregistrés dans les exploitations cette année-là. Ce pourcentage, brandi pour tourner la menace en ridicule, ne dit pourtant rien de la gravité des actes concernés. Imagine-t-on une trentaine d’intrusions dans des laboratoires, des églises ou des préfectures sans provoquer une réaction sécuritaire ? Ce deux poids, deux mesures est révélateur du regard idéologique que ces militants portent eux-mêmes sur la question.
A lire aussi : Chasse : la reconquête de l’opinion a commencé
Par ailleurs, l’agribashing ne se résume pas à des intrusions. Il s’agit aussi d’une atmosphère de stigmatisation, de pression sociale et de menaces parfois anonymes subies par les agriculteurs, souvent isolés. Laisser croire que ce phénomène est imaginaire revient à nier une réalité vécue sur le terrain.
Une contestation de la légalité qui tourne à l’acharnement
L’un des points centraux de la tribune repose sur un contentieux juridique. En 2022, saisis par l’association L214, les juges administratifs avaient reconnu comme illégales certaines missions de la cellule Déméter, notamment le suivi des actions idéologiques. Mais cette décision a été annulée par le Conseil d’État en novembre 2024. Cette décision finale — émanant de la plus haute juridiction administrative française — est balayée d’un revers de plume par les signataires, qui annoncent désormais un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
Il ne s’agit plus d’interroger la légalité d’un dispositif, mais de le délégitimer par tous les moyens, y compris en contestant les décisions des juridictions nationales. L’on peine à voir dans cette stratégie un attachement sincère à l’État de droit, dès lors qu’il ne va pas dans le sens espéré.
Une rhétorique de l’indignation, mais des silences stratégiques
La tribune ne recule devant aucun parallèle douteux : l’agriculture française est comparée aux industries du tabac, de l’alcool ou de la malbouffe, toutes accusées de faire taire les lanceurs d’alerte. Ce glissement rhétorique vise à décrédibiliser l’ensemble du modèle agricole français, en y projetant les logiques cyniques de multinationales sans scrupules.
Mais ce qu’elle tait, c’est la pluralité du monde agricole, les efforts d’innombrables producteurs pour faire évoluer leurs pratiques, ou encore les conséquences humaines du harcèlement médiatique ou militant. Les agriculteurs sont présentés comme les rouages d’un système destructeur, sans qu’à aucun moment leur parole ou leur réalité ne soit prise en compte. La critique devient alors pure abstraction idéologique, déconnectée du terrain.
Il est parfaitement légitime de débattre du modèle agricole, de s’opposer à certaines pratiques, d’alerter sur les effets des pesticides (quand c’est scientifiquement valide) ou de militer pour une autre consommation. C’est même le rôle d’une société démocratique que de faire vivre ces débats. Mais vouloir dissoudre une cellule de la gendarmerie parce qu’elle dérange certaines stratégies militantes revient à confondre liberté de conscience et impunité.
En désignant la cellule Déméter comme une menace pour la démocratie, les signataires de cette tribune usent d’un argumentaire profondément biaisé. Derrière la défense proclamée des libertés publiques, c’est un refus de l’ordre démocratique qui s’exprime : celui où la loi s’applique à tous, y compris aux militants les plus déterminés. Et cela, quoi qu’en disent les pétitions.
A voir aussi :