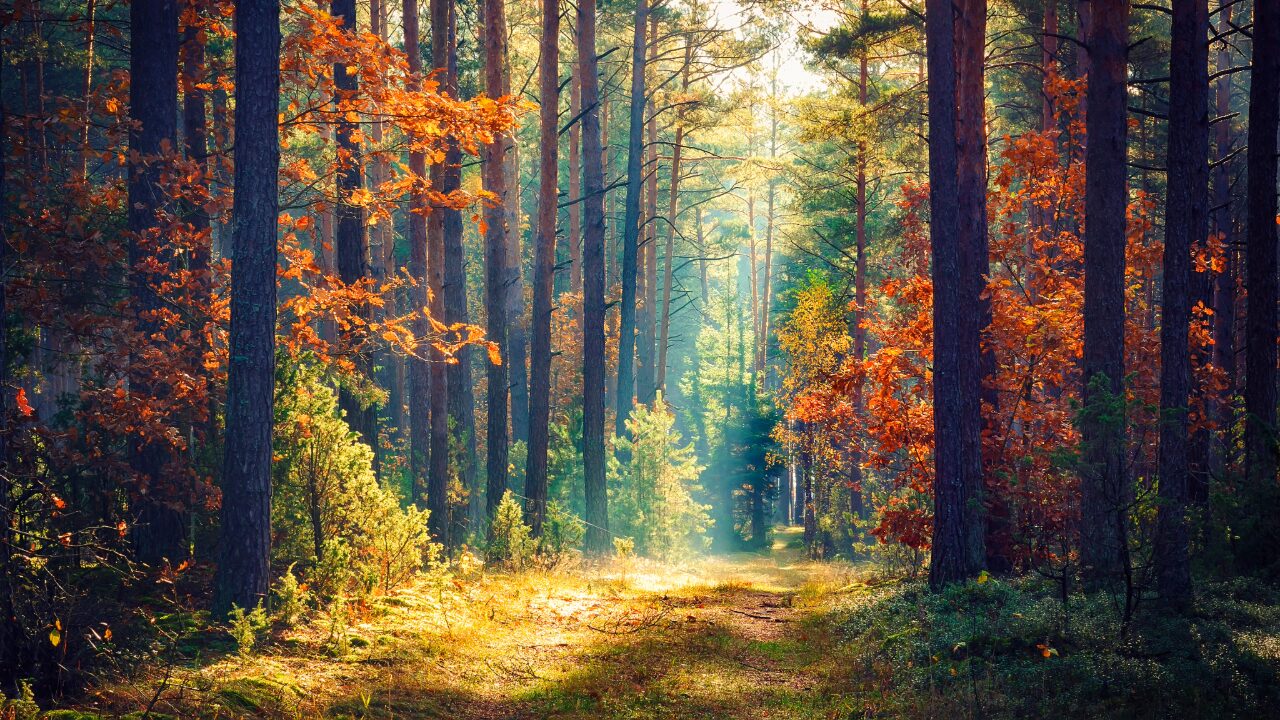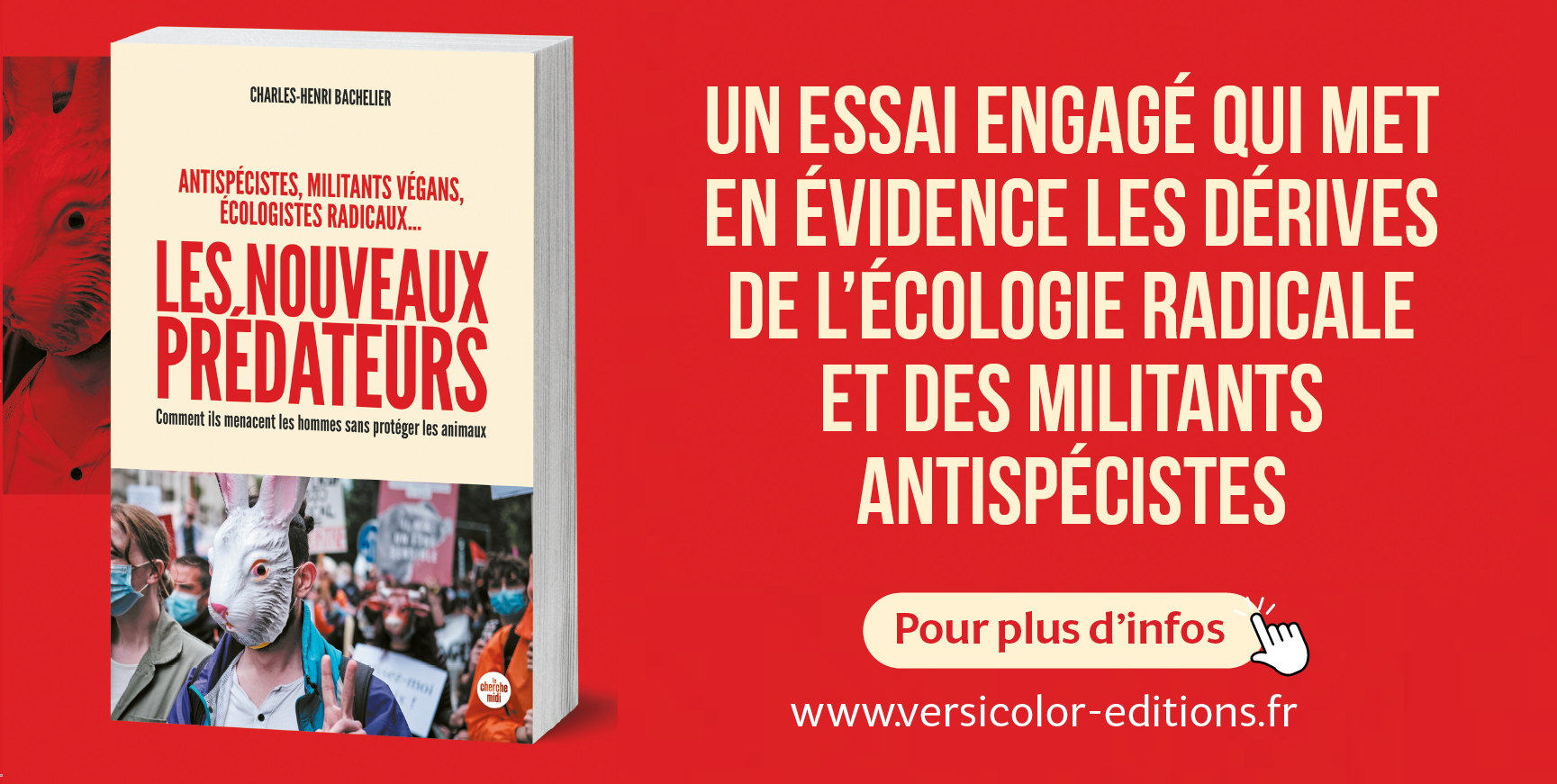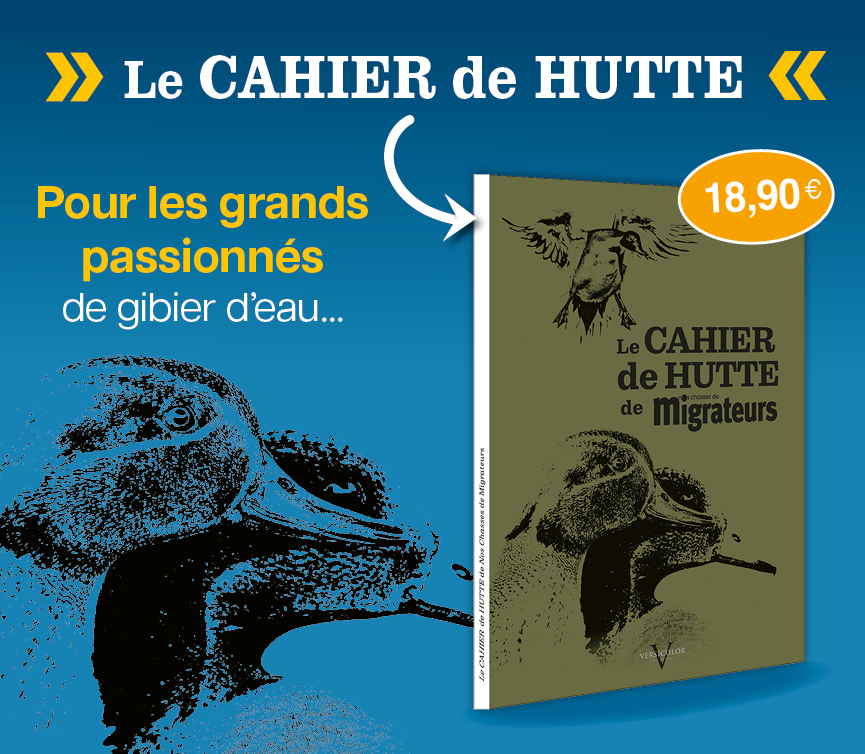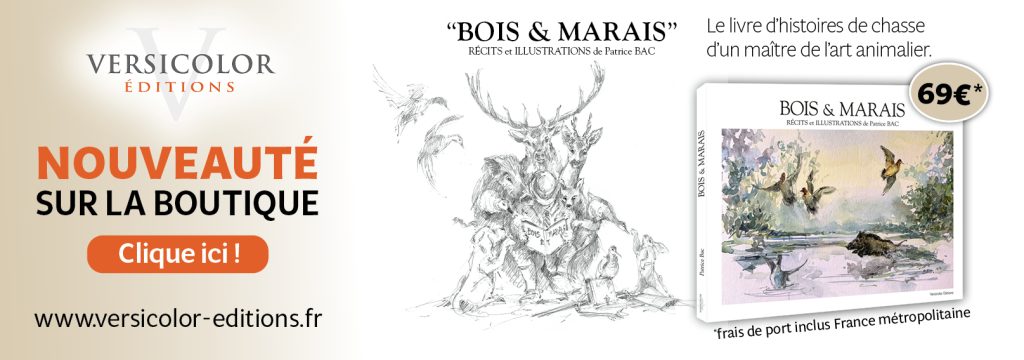Selon 200 chercheurs, même les milieux naturels en apparence préservés sont appauvris : une part importante de la biodiversité, pourtant adaptée, est absente.

Et si la biodiversité qu’on ne voit pas était la plus alarmante ? Une vaste étude mondiale, coordonnée par le réseau DarkDivNet et récemment publiée dans Nature, dévoile une réalité inquiétante : les écosystèmes naturels sont bien plus appauvris qu’ils ne le paraissent, même lorsqu’ils semblent « intacts ». La clé de ce constat ? Une notion aussi fascinante qu’inquiétante : la dark diversity, ou « diversité sombre ».
🌱 Une biodiversité manquante… mais possible
Contrairement aux mesures classiques de biodiversité qui comptent uniquement les espèces présentes dans un milieu donné (ce qu’on appelle la diversité alpha), les chercheurs se sont intéressés ici à ce qu’ils appellent la diversité sombre : toutes les espèces qui devraient pouvoir vivre dans un écosystème donné (parce qu’elles y sont écologiquement adaptées) mais qui en sont absentes.
A lire aussi : Biodiversité : le sondage qui change tout
Autrement dit, ce ne sont pas seulement les espèces qu’on voit qui comptent, mais aussi celles qu’on devrait voir, et qui manquent à l’appel. Leur absence constitue un signal faible, mais globalement cohérent, de l’impact humain profond sur les milieux naturels.
📉 L’empreinte humaine efface la mémoire des écosystèmes
Grâce à des relevés standardisés dans 119 régions et plus de 5 400 sites naturels sur tous les continents végétalisés, les auteurs montrent que la proportion d’espèces adaptées mais absentes — donc la « diversité sombre » — augmente avec l’intensité de l’activité humaine dans la région environnante, jusqu’à 300 km à la ronde.
Concrètement, dans les régions les moins impactées, environ 35 % des espèces végétales adaptées à un site sont effectivement présentes. Mais dans les zones fortement influencées par l’homme, ce chiffre chute à moins de 20 %. C’est un appauvrissement invisible à l’œil nu, mais bien réel.
🔍 Pourquoi ces espèces manquent-elles ?
L’étude avance plusieurs hypothèses : fragmentation des habitats, pollution, perte de connectivité écologique, disparition des pollinisateurs ou des animaux disperseurs de graines… autant de processus indirects mais cumulatifs. Même dans des zones « naturelles », les espèces ont de plus en plus de mal à s’y maintenir ou à y revenir.
L’idée d’un écosystème « complet » est donc largement théorique : beaucoup de milieux sont écologiquement viables pour davantage d’espèces… mais ces espèces sont absentes. Un écosystème « vide de ses possibles », en quelque sorte.
🧠 Une méthodologie innovante, un signal global
Pour évaluer cette dark diversity, les chercheurs ont utilisé une approche probabiliste sophistiquée, basée sur les co-occurrences d’espèces dans les sites voisins. Cela leur a permis de calculer pour chaque site ce qu’ils appellent la community completeness : la proportion d’espèces adaptées qui sont réellement présentes.
C’est cette mesure — plus fine que les comptages habituels — qui révèle la perte. Car en termes de biodiversité observée (alpha diversity), les résultats sont beaucoup plus flous et masquent les effets à long terme.
⚠️ Une alerte pour la conservation
Ce que cette étude nous dit, c’est que l’empreinte humaine ne détruit pas seulement les milieux qu’elle transforme, mais appauvrit aussi ceux qu’elle épargne en apparence. Cela plaide pour une approche de la conservation à l’échelle du paysage, et pas seulement « site par site ».
Autre leçon majeure : la dark diversity est encore là, à portée de recolonisation. Les espèces manquantes existent toujours dans la région, mais il faut lever les freins à leur retour. Ce constat ouvre une fenêtre d’opportunité unique pour la restauration écologique, tant qu’il est encore temps.
🌍 Une biodiversité fantôme, mais bien réelle
En mettant au jour cette « biodiversité fantôme », l’étude change notre regard sur ce qu’est vraiment un écosystème fonctionnel. Un champ rempli de fleurs n’est pas forcément riche. Une forêt silencieuse peut être écologiquement vide. L’illusion d’un paysage naturel ne garantit plus sa santé écologique.
La dark diversity, loin d’être un concept abstrait, devient ainsi un outil de diagnostic essentiel — une manière de mesurer l’absence, ce qui est probablement la façon la plus pertinente de comprendre l’érosion actuelle de la vie.
A voir aussi :